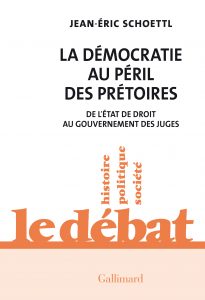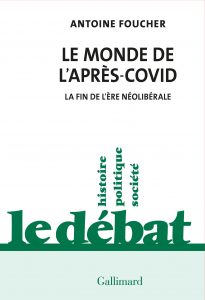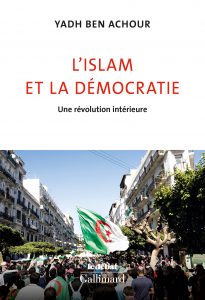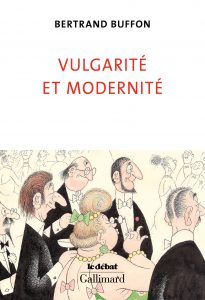Présentation |
L’histoire, c’est-à-dire l’organisation du passé en un ensemble cohérent, sa mise en récit, son rassemblement dynamique en fonction d’un sens, discuté dans son orientation mais indiscutable dans son existence, cette histoire-là est en plein effacement ; et cet effacement n’est jamais plus sensible que dans la transmission et l’enseignement. C’est à ce « difficile enseignement de l’histoire » que nous avons consacré un récent numéro du Débat (numéro 175, mai-août 2013).
En revanche, le passé est omniprésent, comme je l’indiquais dans la présentation générale du numéro. D’une hyper-présence à la fois distante et obsessionnelle, qui habite l’époque sous les formes les plus diffuses et variées. Elle pèse d’un poids que l’on s’efforce de déjouer, de conjurer, d’occulter, de refouler, tantôt par l’indignation morale et la repentance parce que l’on sent le passé accusateur, tantôt par l’indifférence et la dérision parce que, de ce passé, on est complètement coupé. Un passé, du même coup, prêt à tous les usages et toutes les formes d’exploitation, qu’elles soient politiques, économiques ou touristiques.
Auguste Comte distinguait les époques positives et les époques critiques. Les premières, emportées par un élan créateur vers la construction de l’avenir, les secondes tout occupées par la digestion du passé : c’est ce type d’époque que nous vivons.
Puisque le passé ne parle plus de lui-même, chacun peut lui faire dire ce qu’il veut. On appelle encore « histoire », par habitude et facilité, ce nouveau rapport au passé. Mais ce qui était par définition l’établissement d’un lien collectif est devenu appropriation individuelle où dominent les dimensions esthétiques, ludiques, projectives, affectives. C’est là le trait majeur de la culture du passé. Il ne s’agit plus d’insérer son expérience personnelle dans un ensemble collectif, mais de jouer avec un capital acquis. Et ce trait majeur a pour première conséquence, énorme, la disparition du sentiment de la dette envers nos prédécesseurs qui a gouverné les hommes pendant des siècles. L’histoire, qui était par définition le socle du réel, est devenue le domaine de l’imaginaire, le merveilleux de notre âge démocratique.
C’est à une première tentative d’exploration de cette nouvelle culture du passé que ce numéro est pour l’essentiel consacré.
Première approche : les vecteurs traditionnels de la transmission historique, manuels, archives, musées. Tous subsistent sans doute, mais subvertis de l’intérieur et profondément bouleversés. Comment faire un manuel scolaire, assimilable aujourd’hui par les jeunes générations ? Quelle transformation pour les sacro-saintes archives enfermées dans leurs sanctuaires et maintenant offertes au monde entier à l’ère du numérique ? Quelle fonction et quel rôle nouveaux pour les musées devant l’impératif mémoriel que leur inflige l’époque ?
Mais c’est surtout dans deux domaines privilégiés que s’exprime par nature et par définition l’imaginaire du passé : la littérature et les médias.
La littérature : nous avions, il y a deux ans, consacré un numéro spécial à « L’histoire saisie par la fiction » (numéro 165, mai-août 2011). Il mettait en évidence que beaucoup d’historiens professionnels, parmi souvent les plus attachés à l’érudition, connaissaient depuis quelques années une tentation littéraire. Comme si le roman historique ou le recours à l’imagination pure leur permettait de dépasser les limites de leur métier et de saisir ainsi la « vraie vérité » du passé. Réciproquement, beaucoup de jeunes écrivains connaissaient une fascination du passé, d’un passé que l’on pourrait dire à deux pôles. Un passé proche, dont le tragique dominait de tout son poids l’actuel vide historico-politique. Comme si la guerre mondiale, la Seconde mais aussi la Première, leur fournissait un répertoire infini d’intrigues et d’aventures dramatiques. Et un autre pôle, infiniment plus lointain, à l’autre bout de la chronologie, avec, d’une part, les inépuisables ressources de l’Antiquité, saisie dans les moments les plus stéréotypés qu’elle nous a légués d’elle-même. D’autre part, avec le merveilleux médiéval qui a fourni, à lui seul, un véritable genre, la « fantasy », dont l’immense succès populaire de Tolkien a ouvert la voie. L’Antiquité et le Moyen Âge : les deux Far West de notre histoire européenne.
C’est cependant de toute évidence dans les médias que se formulent dans leur richesse et leur complexité les nouvelles formes de présence historique de ce passé anhistorique. Peut-être parce que, dans l’image, le cinéma ou les séries télévisées ne se pose même pas la question sous-jacente et lancinante qui habite l’histoire, l’enseignement et jusqu’à la littérature, laquelle ne se comprend que dans les conditions historiques de son déroulement : pourquoi transmettre le passé ? À quoi peut-il servir ? Les médias se contentent de l’utiliser, de le mettre en scène, en images fortes et en musique. Et même la tentative de reconstitution la plus scrupuleuse relève encore du jeu. C’est pourquoi ce jeu trouve son illustration concentrée dans l’extraordinaire expansion que lui ont donnée la bande dessinée, les jeux vidéo et les séries télévisées. Là, tout y est : les technologies numériques les plus nouvelles au service des clichés les plus répandus du patrimoine historique et mémoriel, le traitement le plus raffiné et le plus ludique de l’imaginaire collectif de base, la mondialisation possible des débouchés et des profits commerciaux et, pour tout dire, la tendance à l’infantilisation générale du monde contemporain.
Que deviennent l’histoire et l’historien dans cette nouvelle configuration temporelle ? Enfermé dans son rôle pédagogique et scientifique, mais maître de l’interprétation d’un passé auquel on devait d’être ce que l’on était, l’historien s’est vu lui aussi entraîné dans de nouveaux rôles, sociaux, civiques et publics dont ce numéro esquisse les contours. Il a perdu son magistère, mais ne demeure-t-il pas, en définitive et malgré tout, celui qui dit ce que le passé permet et ce qu’il ne permet pas ?